
Et si les influenceur·ses devenaient les meilleur·es allié·es des journalistes ?
Longtemps tenus à distance pour leur supposée superficialité, les influenceur·ses deviennent peu à peu des partenaires pour les médias. Ceux-ci leur permettent de toucher des publics que les canaux traditionnels n’atteignent plus, de mieux faire circuler leurs sujets et de renforcer leur impact.
C’est l’un des constats du dernier Digital News Report de l’institut Reuters : 44% des jeunes de 18 à 24 ans s’informent principalement sur les réseaux sociaux. Parmi les utilisateurs de TikTok, Instagram et YouTube, plus d’un sur deux affirme suivre des influenceur·ses pour s’informer. Ces voix séduisent par leur ton direct, leur proximité et leur régularité. Autant de qualités que les médias tentent désormais d’intégrer. D’après Adriana Lacy, fondatrice de l’agence Influencer Journalism, « la narration via les canaux des influenceur·ses génère toujours des taux de rétention plus élevés que les formats traditionnels. » En clair : ces créateur·rices font exister l’information là où les médias ne sont plus attendus.
Depuis fin 2024, Mediapart collabore avec des illustrateur·ices et créateur·rices de contenus comme Cht.am, Camille Blandin ou Le Tréma pour donner une nouvelle visibilité à ses enquêtes. « Si nos sujets intéressent les jeunes, ce n’est pas forcément le cas de nos formats », explique Renaud Creus, Directeur de la communication. « On s’est dit, plutôt que de faire des choses avec notre ton sérieux et classique, trouvons des relais avec des influenceur·ses qui ont leur audience, à qui celle-ci fait confiance et qui font exister des contenus auprès de jeunes publics. »
Les résultats sont probants : davantage de partages sur les contenus cross postés avec les influenceur·ses, plus d’engagement et une audience élargie. « L’objectif principal n’est pas l’abonnement, mais la visibilité pour faire exister nos enquêtes auprès de publics éloignés des médias et nourrir le débat citoyen », précise Renaud Creus. Dernière collab’ : une vidéo où Fabrice Arfi évoque le traitement médiatique de l’incarcération de Nicolas Sarkozy en murmurant au côté du Tréma, fondateur du compte Instagram ASMR Politics.
Briser les bulles algorithmiques
Même logique chez Vert, média écolo qui a intégré à sa rédaction le créateur Gaetan Gabriele, il y a deux ans. « Il avait 25 000 abonnés quand on l’a recruté, il en a aujourd’hui 336 000, et nous 352 000. Nos comptes ont grandi ensemble », raconte Loup Espargilière, cofondateur. Le ton accessible du créateur attire un public plus jeune vers les sujets de fond. « Avec lui, on brise nos bulles algorithmiques ».

Cette approche est aussi une réponse aux nouvelles contraintes imposées par les plateformes. « Travailler avec des influenceur·ses peut être une façon intelligente de contourner certains blocages, observe Marine Doux, directrice éditoriale de Médianes. Depuis octobre, Meta a interdit les publicités dites ‘politiques, électorales ou sociales’, rendant le travail des médias beaucoup plus complexe. »
Et parfois, l’effet dépasse la sphère médiatique. « Quand les influenceur·ses se sont mobilisés pour la pétition contre la loi Duplomb (NDLR, proposition de loi adoptée à l’été 2025, critiquée par ses détracteur·ices pour affaiblir la biodiversité et faciliter les élevages intensifs. Une pétition lancée par une étudiante, Eléonore Pattery, contre ce texte a récolté plus de 2 millions de signatures) visant à “lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur”, ils ont eu une portée monstrueuse, raconte Loup Espargilière. Le sujet est très austère et technique, et plein de créateur·rices ont réussi à expliquer simplement ce qu’il y avait dans le texte. Les gens ont eu envie de comprendre, de partager et de signer la pétition. » Pour lui, ces mobilisations illustrent la nouvelle puissance des influenceur·ses : « Ils sont aujourd’hui des acteur·rices de l’information et de la mobilisation à part entière. Individuellement, mais surtout collectivement, ils peuvent faire émerger des sujets et permettre au public de prendre conscience de certains enjeux. »
Une co-création éditoriale
Chez Vert comme chez Mediapart, ces collaborations reposent sur une co-création éditoriale. Les influenceur·ses travaillent avec les journalistes, et les vidéos passent par la case édition avant publication. « Des formes plus légères peuvent mener à des erreurs. On fait donc tout valider par l’auteur de l’article », insiste Renaud Creus.
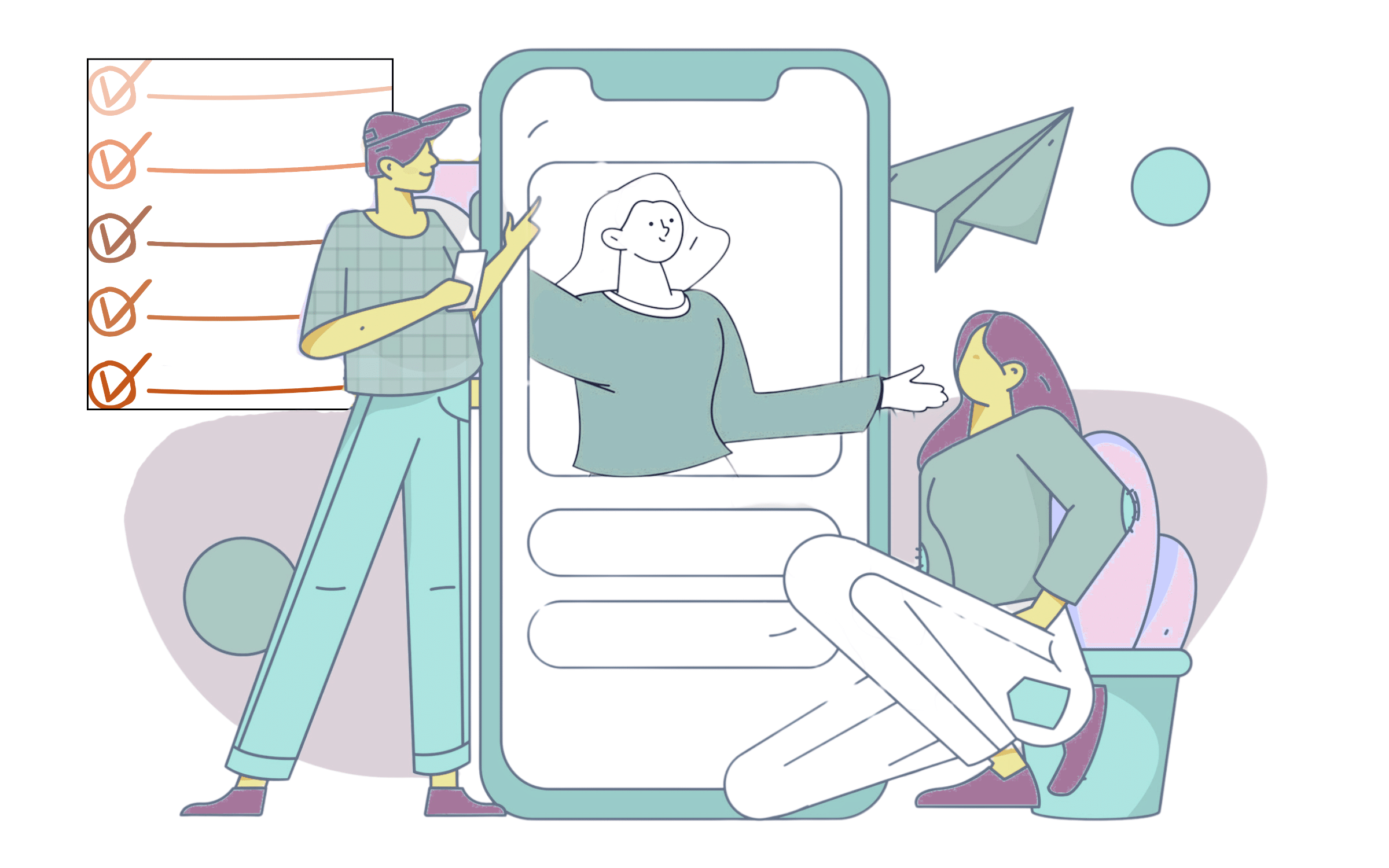
Élargir son champ d’action
En 2022, le média LAist a diffusé une enquête citoyenne via cinq influenceur·ses de Los Angeles, pour déterminer quelles priorités la population locale souhaitait que la nouvelle mairie adresse durant son mandat. « Si nous voulions utiliser ces données pour définir comment axer notre couverture médiatique de la nouvelle administration, il fallait élargir notre champ d'action », explique Ariel Zirulnik, alors journaliste chargé de la communauté. Résultat : 30 % des réponses provenaient des communautés des influenceur·ses , plus jeunes et plus diverses que les répondant·es habituel·les.
Certaines rédactions, comme StreetPress, vont plus loin. En prévision des municipales, le média prévoit d’ouvrir des formations à des créateur·rices de contenus afin qu’ils se sentent légitimes à traiter des sujets sensibles, comme la lutte contre l’extrême droite. Et aux États‑Unis, l’organisation Factchequeado a formé des créateur·rices latino‑américain·es à repérer les fausses informations et à communiquer de façon responsable : « Nous avons développé un cours co‑créé avec des influenceur·ses qui voulaient informer correctement mais avaient peur d’être ‘cancelled’ s’ils abordaient certains sujets », explique l’équipe. Résultat : ceux-ci ont mieux armé leur audience, souvent jeune et utilisatrice principale des réseaux, à distinguer l’info de la rumeur.
Peut-être est-il temps, non pas de craindre les influenceurs et leur mauvaise influence, mais d’en faire, au contraire, un levier de reconquête démocratique.
Rembobine, le média qui lutte contre l'obsolescence de l'info Bulletin
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les dernières mises à jour dans votre boîte de réception.










